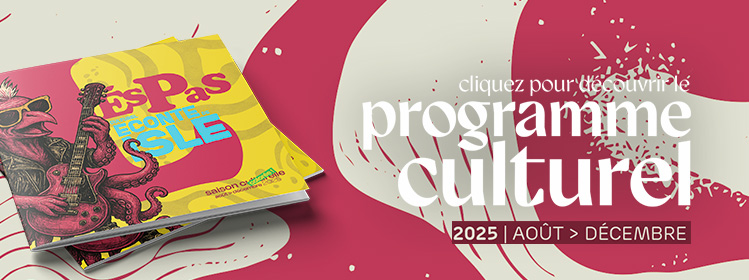Comment rendre nos institutions absurdes en quatre leçons, plus une
 Association d'Irène
Association d'Irène Tout public
Tout public
Avec comme argumentaire : Faut-il améliorer les conditions de travail ? On aimerait bien. Mais à considérer comment les choses évoluent, il semble que ce soit un tout autre défi qui est en passe d’être relevé : puisque le travail est déjà pénible, n’y aurait-il pas moyen de le rendre, en plus, absurde ? A en croire les observateurs avisés, les génies en ce domaine pullulent. Quels sont donc leurs recettes ?
Nous sommes dans une impasse : d’une part à en croire les sociologues, nos institutions sont en crise et d’autre part, nous ne pouvons pourtant nous en passer. Pour éclairer ces deux propositions, il faut sans doute rappeler que toute institution présente deux faces. D’une part ce que l’on appelle l’institué, et d’autre part, l’instituant. L’institué désigne les moyens concrets nécessaires à leur fonctionnement : cela va des bâtiments à l’organisation de travail en passant par leur financement. L’instituant, quant à lui, renvoie à la finalité des institutions : en un mot, une institution a pour mission d’élever un être humain au statut de personne, ou, dit autrement, de soutenir le déploiement de tout être humain en tant qu’humain : les exemples de l’école ou des soins de santé sont pour le moins évidents.
De cette distinction classique, on tirera deux enseignements : tout d’abord, il n’existe pas d’êtres humains ou de sujets sans institution instituante : et c’est la raison pour laquelle on ne peut s’en passer. Dit autrement, celui qui veut détruire une civilisation cherchera à détruire toutes ses institutions. Ensuite, la crise de nos propres institutions devient lisible : elle se laisse lire comme l’effacement de leur vocation instituante sous l’omniprésence de l’institué et de ses dysfonctionnements. En un mot, nos institutions sont devenues déshumanisées et déshumanisantes. Faut-il y voir les symptômes d’un déclin de notre propre civilisation ?
Certains prônent la nécessité d’une désinstitutionnalisation de la société, puisque les institutions se révèlent néfastes, trop coûteuses, etc. Cette voie est malheureusement à proscrire car elle revient à parachever l’œuvre de déshumanisation de l’humain. Pour notre part, nous ne voyons qu’une issue : comment institutionnaliser autrement nos institutions, c’est-à-dire comment les réenchanter, comment rendre à l’instituant toute sa place.
Notre propos se gardera de tomber dans les illusions d’une utopie imaginaire. Ce qu’il faut penser, c’est non pas des institutions harmonieuses et réconciliées, mais bien plutôt des institutions réelles et concrètes où l’institué et l’instituant restent en tension : les moyens limitent et parfois contrarient inévitablement l’humain, lequel fait tout aussi inévitablement violence aux moyens dont il ne se satisfait jamais. La question est de savoir comment rendre cette tension la plus positive possible, en se gardant de croire que c’est toujours possible. Mais pour donner une chance à cet équilibre toujours précaire, il faut sans doute pouvoir poser un diagnostic sur les dysfonctionnements actuels de l’institué et leurs conséquences sur les travailleurs. Les spécialistes du monde du travail distinguent volontiers au moins quatre causes. 1) Le travailleur est dépossédé de la finalité de son travail, 2) il n’en fixe plus non plus les procédures, 3) il est soumis à des évaluations permanentes à partir de critères inadéquats et 4) il est mis constamment en concurrence, en interne avec ses collègues et sur le plan international, avec une main d’œuvre moins onéreuse.
Des initiatives de plus en plus nombreuses existent, dans tous les secteurs du travail, qui donnent à penser que l’on peut changer la situation actuelle. Quelques exemples seront proposés, en guise de conclusion.
A propos du conférencier
Docteur en philosophie et Bachelier en théologie, Jean-Michel Longneaux est chargé de cours aux Facultés universitaires de Namur. Ses recherches portent sur la phénoménologie et plus particulièrement sur les questions liées à l’éducation, à la relation amoureuse, aux soins de santé et à la fin de la vie
Ouvrage récent : “Finitude, solitude, incertitude : philosophie du deuil (2020) ”